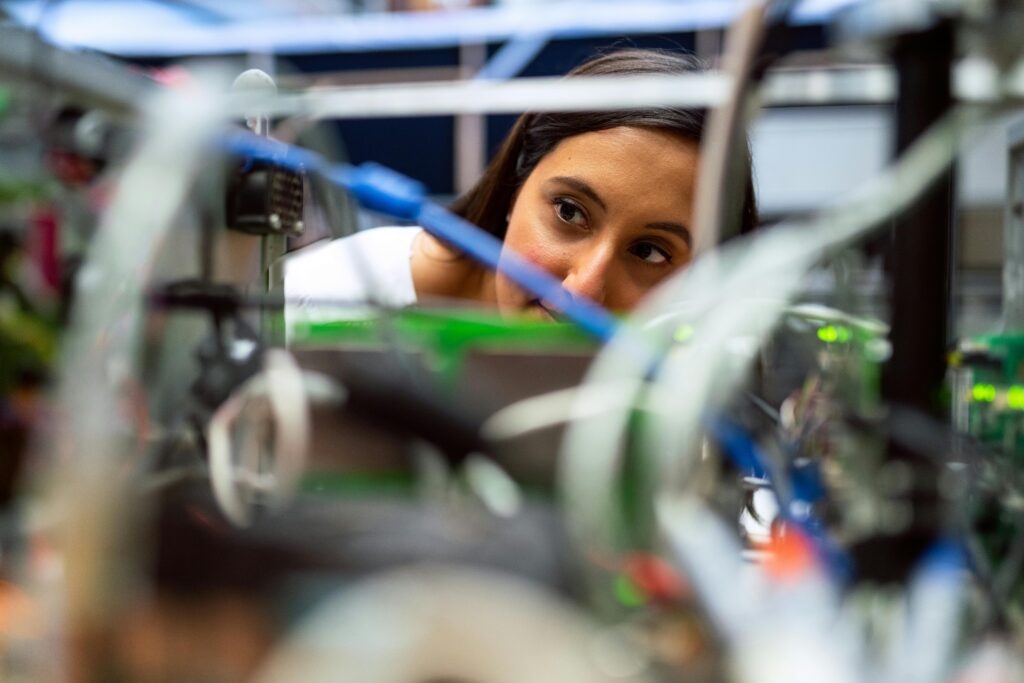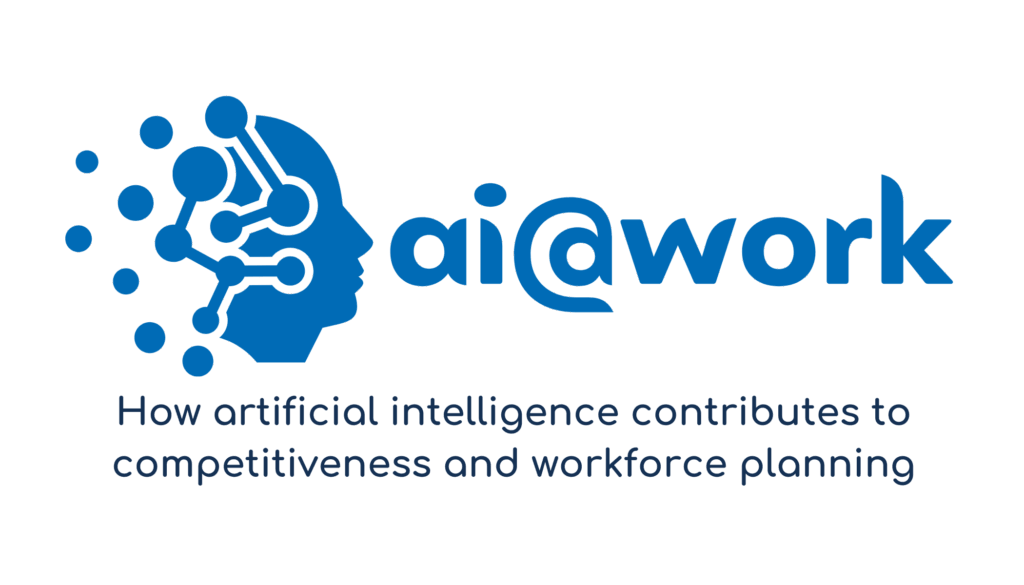[1/2] Le constat est implacable : bien que majoritaires à l’entrée du lycée, les filles désertent massivement les filières de Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STEM). Un « tuyau percé », que Bénédicte Robert, inspectrice générale à l’Inspection Générale de l’Éducation, du Sport et de la Recherche (IGESR), décrypte le cadre d’un rapport « Filles et mathématiques : lutter contre les stéréotypes, ouvrir le champ des possibles ».
Vous utilisez la métaphore du « tuyau percé » pour décrire la diminution progressive du nombre de filles dans les filières STEM. Quelles sont, selon vous, les principales « fuites » à chaque étape du parcours scolaire et universitaire ?
La métaphore du « tuyau percé » illustre la diminution progressive et continue de la proportion de filles dans les filières de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM) tout au long de leur parcours de formation.
La première déperdition massive s’opère dès le lycée, au moment des choix de spécialités. Alors que les filles sont majoritaires en seconde générale et technologique (55%), cette majorité ne se traduit pas par un investissement équivalent dans les matières scientifiques. Ainsi les filles sont sous-représentées dans les quatre enseignements de spécialité (EDS) STEM que la mission a retenus (mathématiques, physique-chimie, sciences de l’ingénieur, numérique et sciences informatiques).
Si les filles sont majoritaires en seconde générale et technologique, elles sont sous-représentées dans les quatre enseignements de spécialité STEM
La fuite la plus critique se situe à la fin de la classe de Première. Beaucoup de filles, y compris celles issues de la triplette la plus scientifique (Mathématiques – Physique-Chimie – SVT), choisissent de conserver PC et SVT, avec l’option « mathématiques complémentaires », un choix qui ferme la porte à de nombreuses filières STEM post-bac.
Après le baccalauréat, même parmi les filles ayant un profil scientifique solide, beaucoup ne choisissent pas les filières STEM les plus sélectives ou les plus mathématisées. Le graphique ci-dessous résume cela très bien. A noter que cette fuite se poursuit également à l’entrée dans la vie active : même diplômées d’une filière STEM, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à ne pas faire carrière dans ces secteurs.
Dans les évaluations nationales et internationales (PISA, TIMSS) récentes des écarts de performance entre filles et garçons ont été mesurés. Le rapport conclut que si un écart existe en faveur des garçons, son ampleur est faible. Statistiquement, et en s’appuyant sur la métrique du « d de Cohen », l’écart filles-garçons en France (d ≈ 0,2) est cinq fois moins important que l’écart de niveau entre les élèves issus de milieux favorisés et défavorisés, ou que l’écart entre la France et Singapour.
À niveau égal, voire supérieur, les filles choisissent une autre voie que les filières scientifiques
Par ailleurs, le rapport s’est penché sur le vivier féminin pour les formations scientifiques sélectives. Le rapport montre que, parmi les filles admises en filière STEM via Parcoursup mais qui refusent toutes leurs propositions, une grande partie a des notes en spécialité mathématiques supérieures à la médiane des admis (filles et garçons confondus) dans ces mêmes filières. À niveau égal, voire supérieur, elles choisissent une autre voie.
Donc ce n’est pas un problème de niveau scolaire. La vraie raison, c’est le poids écrasant des stéréotypes de genre. L’idée que « les maths, c’est pour les garçons » reste très présente et joue un rôle très important à l’adolescence, période de construction identitaire, où s’identifier comme « féminine » peut sembler incompatible avec l’image « masculine » des sciences. A cela s’ajoute la « censure sociale » : Les filles sont régulièrement exposées, de la part de leurs pairs et parfois des adultes, à des remarques qui remettent en cause leur légitimité dans les filières scientifiques. Le rapport parle d’une « censure sociale » qui conduit à une « autocensure » : les filles finissent par intérioriser le message que leur place n’est pas là.
Si le problème est avant tout culturel, comment chacun (parents, enseignants, conseillers d’orientation, et chefs d’entreprise) peut-il agir concrètement pour changer la donne ?
Le rapport insiste sur le fait que la lutte contre les stéréotypes de genre en STEM est l’affaire de tous. Il propose une série d’actions concrètes pour chaque acteur de la chaîne éducative et professionnelle, afin de créer un écosystème plus inclusif et égalitaire.
Concernant les enseignants, le rapport fait un certain nombre de préconisations, autour notamment de la pédagogie égalitaire, qui ont d’ailleurs largement été reprises dans le plan « Filles et maths ». Le monde économique est un partenaire indispensable : la mise à disposition de rôles modèles et de mentors est l’une des actions les plus efficaces, scientifiquement éprouvée.
La lutte contre les stéréotypes de genre en STEM est l’affaire de tous
Les rôles modèles sont un levier puissant contre l’autocensure des filles. Comment mieux les déployer à grande échelle ?
Basé sur l’évaluation d’expériences existantes (notamment le programme de la fondation L’Oréal), le rapport définit les conditions du succès de l’intervention des « role model » : l’intervenante doit être « accessible », c’est-à-dire suffisamment proche des élèves en âge, en parcours ou en milieu social pour que l’identification soit possible ; le discours doit être préparé pour être positif et inspirant, en évitant d’insister sur les difficultés et les sacrifices.
L’idéal serait que chaque fille au lycée général et technologique bénéficie d’au moins une intervention par an, de préférence en demi-classe pour favoriser les échanges, et à des moments clés juste avant les choix d’orientation. Le ministère est actuellement engagé, avec ses partenaires, dans une stratégie de déploiement à grande échelle.
Pour aller plus loin
Si les efforts collectifs portent leurs fruits et que les femmes trouvent pleinement leur place dans l’industrie, à quoi pourrait bien ressembler l’industrie française dans dix ans, en 2035 ? Comment l’arrivée massive de femmes dans l’ingénierie, l’informatique et la recherche transformerait-elle l’innovation, la culture d’entreprise et la compétitivité nationale ? Dans un second volet, Bénédicte Robert explore cette future industrie plus paritaire et plus performante, en analysant les défis et les opportunités d’une véritable égalité des chances dans les métiers de demain.