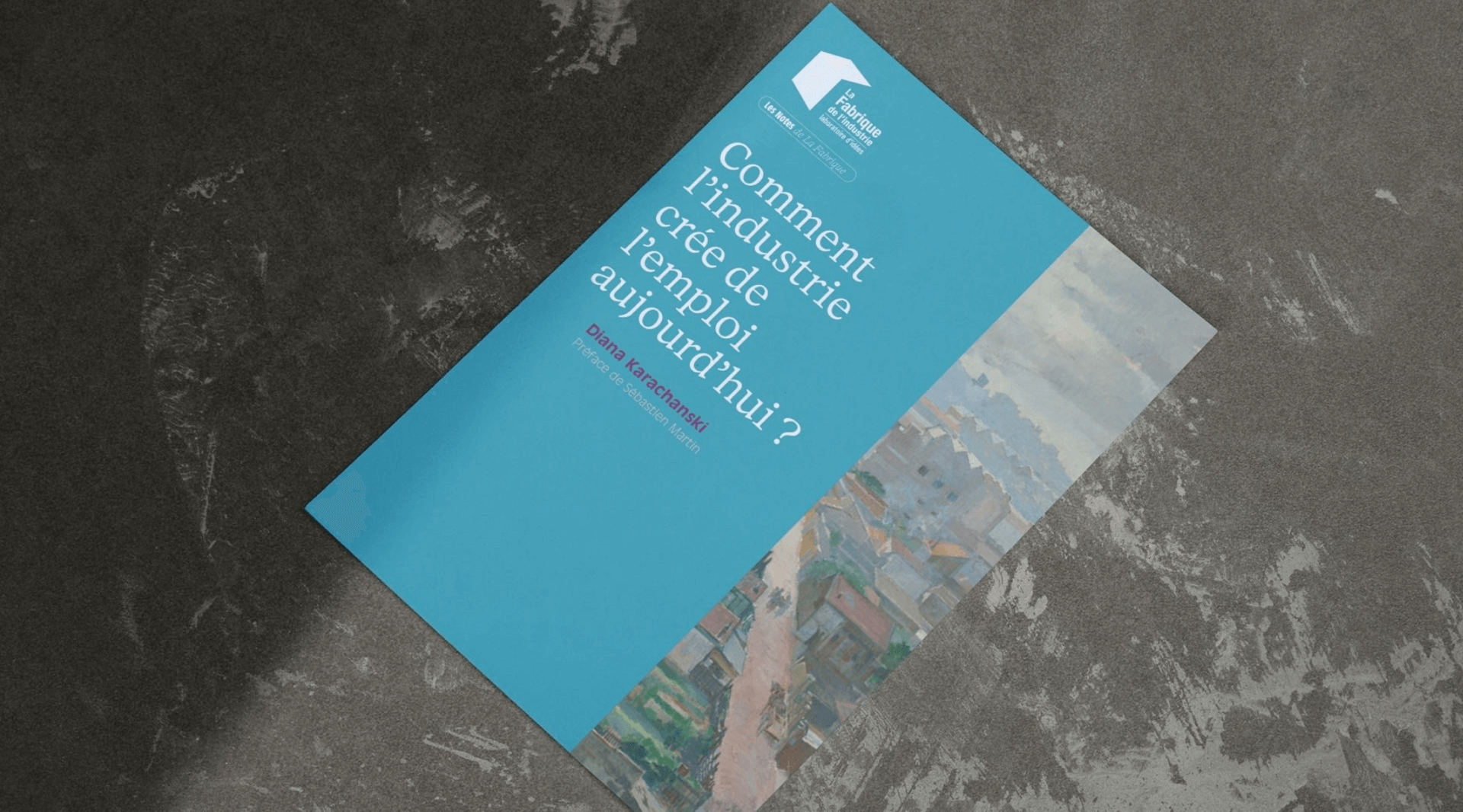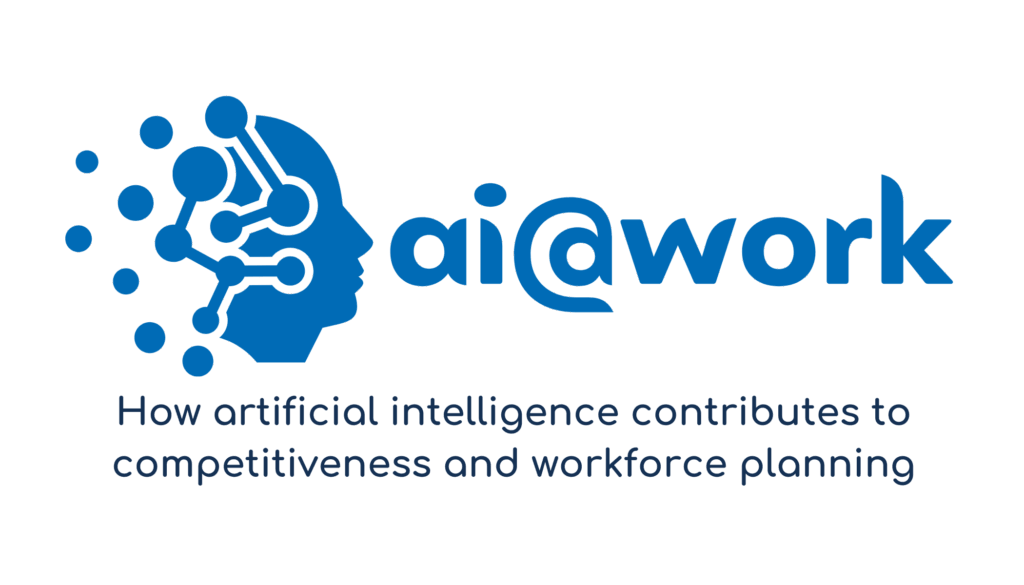Les emplois industriels créent des emplois supplémentaires dans les services. C’est l’un des enseignements phare de l’étude « Comment l’industrie crée de l’emploi aujourd’hui ? » publiée par La Fabrique de l’industrie. Diana Karachanski, économiste et auteure de l’étude, décrypte ce phénomène et les enseignements à en tirer.
L’étude montre une hausse de l’emploi industriel de près de 7 % entre 2018 et 2024. Qu’est-ce qui explique cette reprise ?
La dynamique observée est inédite. Nous observons des créations nettes dès 2016. Trois éléments semblent déterminants. D’abord, l’innovation technologique : la diffusion de nouvelles technologies a possiblement soutenu la productivité, facilitant les créations d’emplois. En second, les politiques publiques (crédit d’impôt en faveur de la recherche, crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, France 2030, France Relance, etc.), ont pu aussi avoir des effets tangibles. Enfin, il existe un phénomène de reconfiguration des chaînes de valeur. La mondialisation a ralenti, avec moins de délocalisations et même quelques relocalisations dans les grandes zones régionales.
Pourquoi est-il crucial de maintenir cette dynamique ?
Parce que l’industrie joue un rôle structurant : elle est non seulement créatrice directe d’emplois, mais aussi indirecte. Selon nos calculs, 100 emplois créés dans les secteurs exposés à la concurrence internationale entraînent la création de 134 emplois dans les services locaux (crèches, commerces, restauration, etc.) sur la période 2007-2023. Cet effet d’entraînement mesuré dans l’étude s’applique à tous les emplois exposés, dont l’industrie manufacturière.
« 100 emplois créés dans les secteurs exposés à la concurrence internationale ont conduit à la création de 134 emplois abrités sur la période 2007-2023. »
L’industrie contribue aussi à la cohésion sociale : elle offre une proportion plus importante d’emplois à salaires intermédiaires que le tertiaire, qui tend à être polarisé entre bas et hauts revenus. Elle permet donc de réduire les inégalités et de proposer de vraies perspectives d’évolution de carrière.
Comment se traduit concrètement cet effet d’entraînement ?
Prenons l’implantation d’une usine de moteurs aéronautiques. Elle crée directement des emplois industriels (ingénieurs, techniciens), mais aussi indirectement : comptabilité ou marketing confiés à des entreprises locales, sous-traitance de pièces métalliques, etc.
Ces activités supplémentaires génèrent elles-mêmes des emplois. En parallèle, la hausse des salaires stimule la consommation locale (restauration, coiffure, commerces). Enfin, la concentration d’acteurs industriels favorise les échanges de compétences et la montée en productivité.
Quels leviers permettraient de consolider cet effet favorable sur l’emploi ?
D’abord, il est crucial de préserver le tissu industriel local : beaucoup des créations nettes d’emplois observées viennent du ralentissement des fermetures de sites. Cela passe par l’ancrage territorial, avec par exemple la mise en place de formations adaptées ou de clubs d’entreprises.
« Préserver le tissu industriel local et miser sur la formation »
Ensuite, l’impact est plus fort quand les emplois sont qualifiés et liés à des secteurs intensifs en technologie (pharmaceutique, équipements de transport, communication). Ces emplois génèrent plus de richesse, donc plus de retombées locales.
Quel est le message principal à retenir de votre étude ?
L’industrie reste un moteur essentiel d’emplois, à la fois directs et indirects. Mais la dynamique repose sur les gains de productivité et sur la capacité à maintenir une industrie compétitive et innovante.